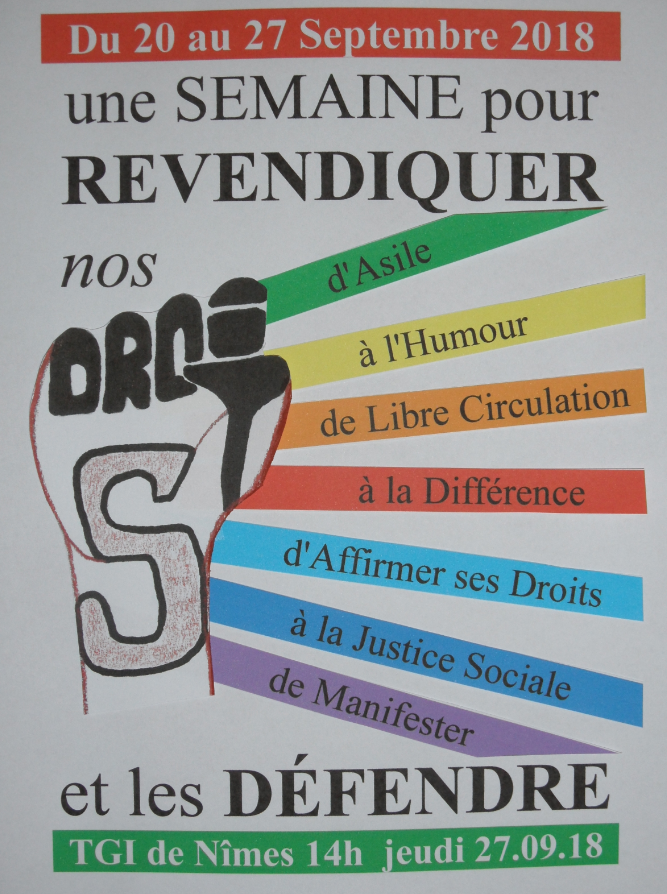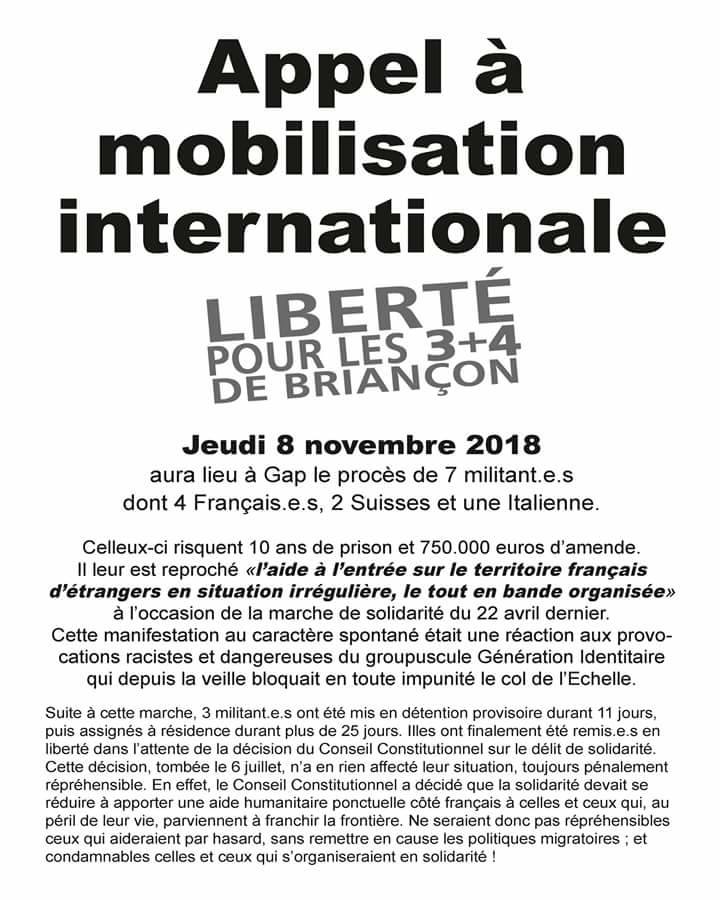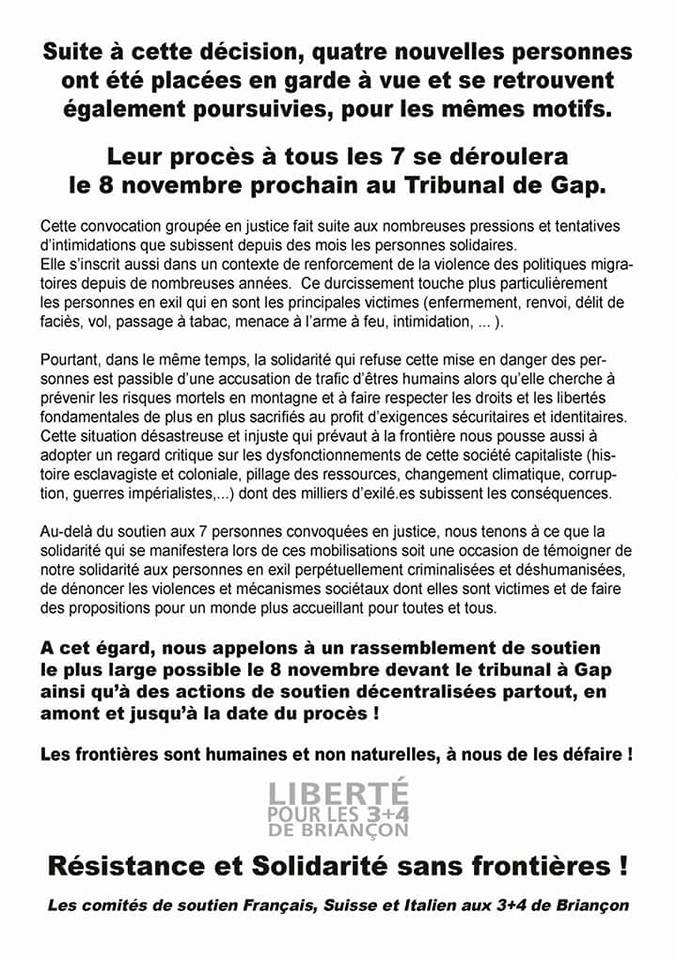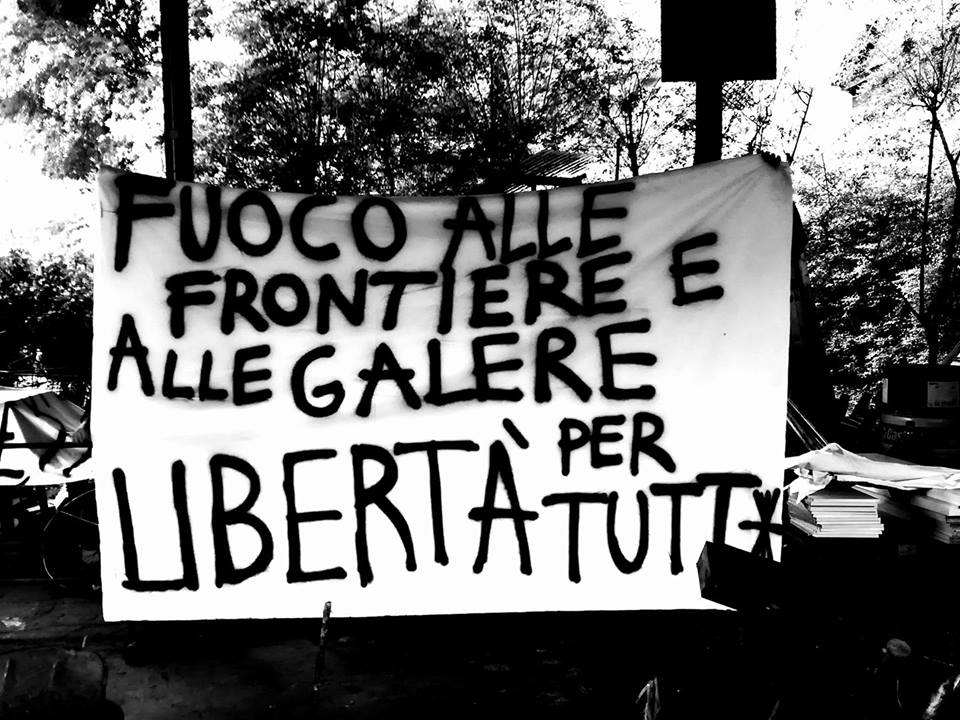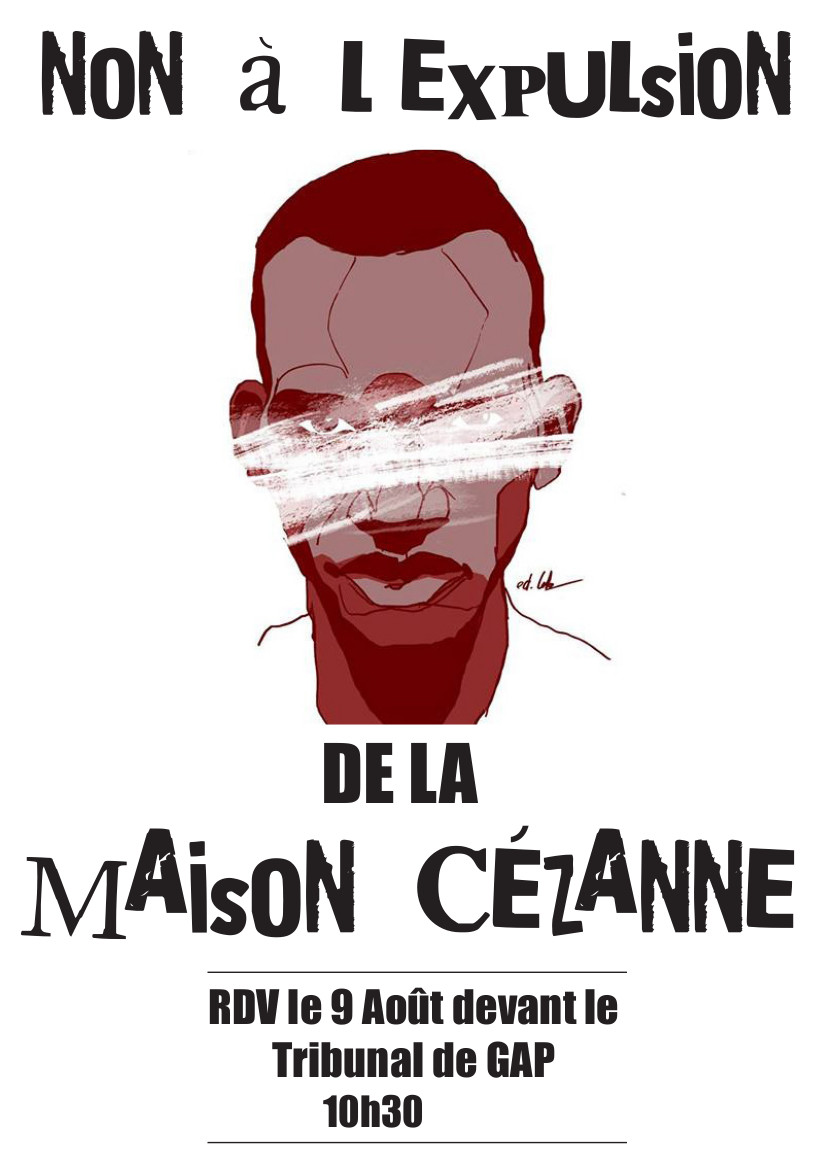Depuis l’élan d’empathie suscité par la photo du petit Aylan retrouvé inanimé le long d’une plage en Turquie suite au chavirement de son embarcation en septembre 2015, force est de constater qu’à peine trois ans après cet événement tragique, le temps n’est plus à la compassion avec les réfugiés dans les discours politiques. La récente agitation autour de la question migratoire occasionnée lors de la tenue du Conseil européen le 28 juin dernier et les tensions s’en dégageant en attestent largement. Le retour du contrôle des frontières est à la bouche de tous les dirigeants politiques, et avec celui-ci, c’est bien le renforcement des États dans leur souveraineté qui en sort affirmé, dégageant au passage une voix royale aux idées nationalistes et identitaires…

La frontière comme symbole de la souveraineté des États
Depuis l’époque moderne, la frontière a été le marqueur de la création des États-nations, de leur délimitation et de l’homogénéité politique exercée sur leur territoire. Là où les confins des grands empires ne se trouvaient autrefois que partiellement définis, leurs limites parfois floues se sont peu à peu précisées pour en arriver aux frontières millimétrées et sécurisées que l’on connaît actuellement. « La frontière est un phénomène très ancien qui ne peut échapper à son ancrage historique. Sa formation, ses significations au cours de l’histoire rejaillissent aujourd’hui sur le droit contemporain. Le tracé d’une limite a permis de concrétiser l’appropriation d’un espace par des groupes d’individus dans le cadre d’entités pré-étatiques ou désormais étatiques. Mais avant de parvenir à ce stade, la frontière a fluctué et son droit avec. Frontières « zones », « épaisses », « marches », « limes », autant de noms pour une même réalité : la frontière reste mouvante et non fixée. Ce n’est que progressivement qu’elle s’affermit dans une conception moderne évoluant vers la frontière ligne. » Les États se sont ainsi constitués par l’agrégation ou la perte de territoires, et avec leur délimitation et la cartographie entamée dans l’Europe du XVIIème siècle, le modèle des frontières s’est peu à peu étendu au reste du monde. C’est donc un espace entièrement étatisé que nous connaissons aujourd’hui, la frontière en fixant chacune des limites.
La frontière est également l’un des attributs de la souveraineté des États sur leur territoire. Représentant au sens strict la séparation entre le début d’un État et le commencement d’un autre, cette ligne de partage entre entités souveraines lui donne une importance politique fondamentale. « La frontière crée l’État selon un processus qui donne à l’État une définition frontalière. Mais elle se situe également au point d’équilibre de trois données sociologiques : le territoire, l’État, la nation, sans que la coïncidence ne soient au rendez-vous. » Nombre de frontières ont ainsi été imposées aux populations sans se soucier des limites traditionnelles, linguistiques, culturelles ou ethniques, notamment par le biais de conquêtes, de guerres, ou par le colonialisme. L’histoire laissant des marques souvent indélébiles dans les identifications qui ont pu se forger ou être créées au cours du temps, le réveil des frontières intérieures, des indépendantismes ou des conflits frontaliers resurgissent inexorablement à chaque endroit de la planète. Les exemples ne manquent pas et l’on pourra penser à l’établissement définitif de la frontière franco-allemande sur le Rhin qui mit plusieurs siècles et nécessita trois guerres dont deux mondiales avant que les rapports de forces ne s’équilibrent en 1945 ; à la question de l’autonomie régionale en Catalogne remise récemment au goût du jour et qualifiée de rébellion par l’État espagnol ; ou à la reprise de la Crimée par la Russie en 2014 après l’avoir cédée à l’Ukraine soixante ans plus tôt. Ces conflits sont autant de revendications de partage de pouvoir, d’autonomie ou de contrôle de zones d’influences, que les États dans leurs orgueils souverainistes, n’ont de cesse de vouloir maîtriser.
Mais la frontière pose aussi la question de son franchissement, et l’on comprend aisément que l’État, se considérant comme garant de l’intégrité et de la sécurité de son territoire, se réserve jalousement le droit d’en contrôler les entrées et les sorties. Si jusqu’au XIXème siècle il était plus facile d’entrer dans un pays que de sortir du sien, un siècle plus tard, c’est bien l’inverse qui a cours. « Dans le passé, beaucoup d’États ont considéré la migration comme une rupture d’allégeance et ont lutté contre le nomadisme pour contrôler leur territoire, car la population était une ressource pour travailler la terre, payer les impôts et faire la guerre. » Aussi, l’émigration et l’immigration ne se conçoivent pas de la même manière selon les époques et les lieux, même si leur traitement reste constamment soumis aux intérêts des États. Les pays de départ durant la première période de grande migration de 1880 à 1920 comptaient principalement des pays Européens bénéficiant d’un rapport de force favorable sur la scène internationale, alors qu’à partir de 1980 se sont des ressortissants de pays pauvres et faibles qui peinent à entrer dans la zone d’immigration qu’est devenue l’Europe. Inversement, des pays comme la Russie ou la Chine sont devenus des régions de départ à partir de 1990 alors que l’émigration n’y était pas possible auparavant.

Dans le contexte récent où les échanges internationaux représentent la condition d’existence du libéralisme économique, les frontières deviennent « des éléments essentiels de la redéfinition des rapports politiques contemporains », tout autant que « des dispositifs complexes de tri des flux de la mondialisation ». La migration devient un enjeu permanent, particulièrement pour les États tentant d’en réguler les entrées qu’ils jugent indésirables. « L’État est le grand perdant de ces mobilités, sa souveraineté étant mise au défi par ces nouveaux acteurs et ses frontières transgressées. La montée du souverainisme, notamment en Europe, tend cependant à remettre en scène l’État au cœur de la gestion des migrations, comme on l’a vu en France et en Italie face à l’arrivée des Tunisiens et des Libyens après la révolution de Jasmin de 2011. » Le rôle des États en terme de contrôle de leur territoire et de leur population est ainsi constamment réaffirmé en même temps qu’il est mis à l’épreuve, leur incapacité à maîtriser l’immigration clandestine étant perçue comme une source d’instabilité ou de menace. Dès lors, les flux migratoires avec leur essor actuel représentent un défi large aux États car ils remettent en cause les fondements de leur autorité. On comprend alors la détermination de ces derniers à maintenir une main de fer sur le contrôle de leurs frontières, allant jusqu’à provoquer le niveau de violence inouï actuellement déployé contre ceux qui tentent de l’outrepasser. Plus insidieusement, c’est bien le droit des individus dans leur liberté à se déplacer face aux prérogatives des États qui entre pleinement en conflit. Ainsi, de l’établissement de la conception de la frontière ligne dans l’Europe du XVIIème siècle à celle de frontière politique aujourd’hui mondialisée, l’exercice de la souveraineté des États reste intrinsèquement liée à l’idée de défense du territoire, et donc, au contrôle de ses frontières.
La frontière comme pilier de la construction européenne
A travers les étapes de sa construction, l’Union européenne a développé une approche complexe et ambivalente de la frontière. Tout en définissant un espace intérieur de libre circulation des personnes où la notion de frontière serait appelée à s’effacer, l’Union privilégie d’autre part, comme garantie à cette liberté, une approche sécuritaire de la migration en venant renforcer son contrôle extérieur. Le lien fondamental de l’État à ses frontières, et donc à sa protection, est ainsi altéré, tandis que l’Union se réapproprie d’une manière toujours plus prépondérante la mission de gestion des flux migratoires et de leur maîtrise.
Les accords de Schengen ont été signés en 1985 en vue d’assurer la liberté de circulation des Européens et d’en renforcer les contrôles à son entrée. Si initialement l’idée de libre circulation était censée prévaloir sur celle de la sécurité extérieure, cette dernière est devenue aujourd’hui le trait essentiel de ces accords. Par la suite, le traité sur l’Union européenne (TUE) réaffirme ce principe et le place en éminente position parmi les objectifs poursuivis par l’UE : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. » La qualification d’« espace sans frontières intérieures » et de « contrôle des frontières extérieures » laisse ainsi entrevoir dans cette même disposition juridique deux conceptions opposées de la frontière : « d’un côté, l’ouverture, l’inutilité croissante, voire l’abolition des frontières intérieures ; de l’autre, le cloisonnement, la limite, le contrôle, donc la nécessité et la pertinence de frontières « extérieures ». » L’Union européenne, tout comme l’État, a besoin de la frontière pour se définir. Elle considère en effet, en vertu du principe fondateur du marché intérieur, la frontière comme un lieu d’échange où la mobilité, et donc les franchissements de frontières, sont une des conditions pour que l’espace communautaire se forme et s’approfondisse. Cette notion montre l’importance fondamentale de la frontière dans la construction européenne et sa conception libérale de développement économique. Ainsi, cet « espace de liberté, de sécurité et de justice » réussirait à la fois à conjuguer les impératifs du marché économique en accordant la liberté à ses travailleurs européens d’être exploités dans le pays de leur choix, et les impératifs de sécurité intérieure en assurant une répression sans vergogne sur ceux qui souhaiteraient y pénétrer.

Cependant, cette distinction entre un « espace sans frontières intérieures » et le « contrôle des frontières extérieures » est loin d’être aussi évidente qu’il n’y paraît, et, mis à part les raisons largement critiquables pour lesquelles celle-ci est opérée, beaucoup d’aspects prêtent à discussion. La liberté de circulation censée être instaurée au sein de l’« espace sans frontière intérieure » est en effet loin d’être avérée, et ses restrictions pourraient se démontrer sur de nombreux niveaux. La possibilité pour les États de réintroduction de contrôles aux frontières intérieures demeure légalement possible. Celle-ci a été élargie en septembre 2017 par une modification du code frontière Schengen proposée par la Commission qui avalise des dérogations toujours plus grandes au principe de libre circulation. D’autre part, les limites à la circulation des ressortissants européens peuvent s’opérer de différents manières. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union conditionne par exemple désormais l’octroi de certaines prestations sociales en fonction du degré d’insertion des citoyens de l’Union européenne dans leur État d’accueil, ce qui en limite en conséquence leur circulation. Mais plus largement et essentiellement, les contrôles ne se limitent pas qu’aux frontières, ou plutôt, la frontière se matérialise sous différentes formes sur l’ensemble des territoires. De la rédaction du moindre acte administratif rendant incontournable l’octroi de documents d’identité, aux contrôles policiers effectués dans les périmètres plus ou moins larges autour des gares, des aéroports et des zones d’attente, la lutte contre l’immigration est bien palpable dans la vie de tous les jours. La frontière devient dès lors omniprésente pour les non-européens, même au sein de l’« espace sans frontières intérieures ». Faut-il y voir là une simple contradiction de l’« esprit Schengen » ou bien l’une des conditions de sa réalisation ?
D’autre part, les contrôles ne s’effectuent pas majoritairement à la « frontière extérieure », mais souvent bien au-delà de l’espace européen. C’est d’ailleurs là l’un des aspects alarmant de la politique migratoire de l’Union qui intègre depuis une vingtaine d’années, notamment avec les accords d’association et la politique de voisinage, de plus en plus de pays tiers à sa politique d’externalisation, de gestion et de contrôle migratoire. De plus, avec l’introduction des questions d’asile et d’immigration instaurées dans le champ du droit de l’Union depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, l’Union acquiert un rôle toujours plus conséquent dans le traitement des politiques migratoires, pouvant interférer avec celui des États. C’est le cas notamment du règlement Dublin attribuant la responsabilité de la prise en charge des demandeurs d’asile au premier pays d’entrée dans l’espace européen, et où les pays frontières tel la Grèce, l’Italie ou l’Espagne se retrouvent sommés d’assurer le service d’ordre de l’Union européenne. Ou encore au processus de relocalisation des réfugiés qui impliquait le principe de leur répartition au sein des États membres, et qui fut un cuisant échec dû au refus de nombreux États d’y consentir. Outre que ce type de mesures font l’objet de vives dissensions entre États membres, celles-ci s’immiscent au sein même de l’espace européen, tout en en renforçant le rôle de ses frontières extérieures.
Ainsi, la matérialisation du système de contrôle de la frontière européenne s’applique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire, et se focalise également sur les points névralgiques de la frontière extérieure. Les prérogatives de sa mise en œuvre sont partagées assez confusément entre des acteurs et/ou entités nationales, européennes, voire internationales. C’est le cas notamment de la gestion des hotspots en Grèce, où la responsabilité du fonctionnement est à la charge des autorités grecques, tandis que les missions de contrôles et de surveillances sont assurées par les agences européennes Frontex, Europol (Office Européen de Police) et Eurojust (Agence Européenne de coopération judiciaire), celles de l’identification et de l’enregistrement le sont par l’EASO (Bureau européen d’appui en matière d’asile), l’aide humanitaire est prise en charge par diverses ONG internationales, et le financement est en partie onusien (Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies). Les « entrées » sur le continent sont essentiellement conditionnées au bon vouloir de l’Allemagne, tandis que les « sorties » le sont par l’accord de réadmission conclu avec la Turquie. Cet exemple significatif montre à quel point la frontière fait l’objet d’interactions complexes entre différents types d’acteurs, et de quelle manière la détermination de leurs relations sera prédominante dans l’élaboration et l’application des politiques migratoires à venir.

La frontière comme levier des nationalismes
Le contexte récent d’un retour sur le devant de la scène politique européenne des courants nationalistes et identitaires intervient à un moment où la question migratoire fait l’objet de vives tensions au sein des gouvernements et d’un traitement répressif sans précédant. Le lien entre la peur de l’immigration et la montée des partis d’extrême droite n’a en soi pourtant rien de nouveau, et il ne semble pas réellement surprenant qu’en période de « crise », l’étendard nationaliste soit brandi et entraîne avec lui son lot de xénophobie et de racisme. Pour autant, cette instrumentalisation de l’immigration ne saurait être la seule justification à la recrudescence identitaire actuelle, et il semble important d’en analyser également les dynamiques et les causes plus profondes.
Les frontières définissent en effet les « périmètres de l’exercice d’une souveraineté », et sont « des marqueurs symboliques, nécessaires aux nations en quête d’un dedans pour interagir avec un dehors. » Elles représentent ainsi le point de rencontre entre différents acteurs interagissant selon des intérêts souvent divergents. De nombreuses vagues d’immigration ont régulièrement pris forme dans un passé proche suscitant des crises migratoires plus fantasmées que réelles. On l’a vu dans les années 1990 avec les réfugiés fuyant les conflits déchirants plusieurs pays des Balkans, au début des années 2000 avec les nombreuses pateras défiant les courants du détroit de Gibraltar pour accoster en Espagne, ou en 2011 quand les révolutions du printemps arabe se soldèrent par un nombre important d’exilés en partance pour l’Europe. Cependant, la « crise des réfugiés » de 2015 a révélé au grand jour à la fois les manquements et les contradictions de l’Union européenne dans sa politique migratoire. Elle a montré également les limites de sa cohésion politique en s’affichant à travers un système de gestion des flux semblant au bord de l’implosion. De la faillite du règlement Dublin à l’échec des programmes de relocalisation ; du retour des contrôles systématiques des frontières au sein de l’espace Schengen à la gestion dans l’urgence des camps frontaliers et métropolitains ; ou encore, de l’impossibilité d’aboutir à la redéfinition du système commun en matière d’asile et d’immigration en gestation depuis plusieurs années aux refoulements illégaux des demandeurs d’asile, les dissensions au sein des États membres paraissent à leur paroxysme, et les mouvements nationalistes saisissent pleinement cette brèche pour s’imposer. L’exemple Allemand où le ministre de l’intérieur, Horst Seehofer, use de la question migratoire pour défier sérieusement la chancelière Angela Merkel l’illustre parfaitement.
Idéologiquement, le nationalisme pour arriver à des fins identitaires se nourrit de différentes thématiques, qu’elles soient de l’ordre de l’atteinte à l’autorité de l’État, ou de la transgression du principe de souveraineté. « Le thème de la menace, du défi, de l’invasion, voire « grand remplacement » démographique et culturel, est très présent dans le discours nationaliste à propos de la frontière. […] Ce que cherche à faire valoir les nationalismes, c’est la frontière menacée dans la légitimité même de son existence par les flux migratoires. La perte du contrôle de leurs frontières par les États d’accueil, fruit d’une crise liée à la migration globale, étaie cette revendication. » Cet argumentaire a récemment été illustré de manière exemplaire par la coalition du nouveau gouvernement italien dans le cadre de sa campagne anti-migratoire lorsqu’elle a interdit à plusieurs navires de sauvetage en mer de débarquer des réfugiés sur son territoire. Un symbole fort pour le dirigeant du parti d’extrême droite Mateo Salvini, qui à la veille du Conseil européen, entendait à la fois montrer une volonté de stopper l’immigration clandestine dans son pays, mais aussi affirmer sa souveraineté sur le contrôle de ses frontières en empêchant des organisations internationales non gouvernementales d’y débarquer. C’est également le cas lorsque le premier ministre hongrois Viktor Orbán prophétise dans son discours tenu lors de la fête nationale le 15 mars 2018 la disparition de l’Europe occidentale, son « invasion culturelle » et en appelle à la jeunesse émigrée pour défendre la patrie menacée dans sa survie par les flux migratoires.

Cependant, si la montée actuelle des partis nationalistes s’appuie sur la question de l’immigration pour servir leurs intérêts politiques d’accès au pouvoir – la « crise migratoire » de 2015 ayant dans ce sens fourni un détonateur idéal aux propagandes réactionnaires – , celle-ci bénéficie largement du traitement sécuritaire notamment porté par les instances européennes depuis des décennies. « L’élaboration par l’Union européenne d’une politique commune en matière d’immigration et d’asile fournit, depuis la fin des années 1990, un bon exemple de la transformation d’un phénomène naturel – les migrations internationales – en péril dont il faudrait se prémunir. » Il est possible de citer rapidement ici quelques exemples de mécanismes de contrôles aux frontières comme : l’institution en 1986 de l’obligation de visa d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants non européens, le système d’information Schengen (SIS) qui regroupe les informations nationales relatives au passage, au séjour clandestin et à la délinquance des immigrés, la mise en place du fichier Eurodac en 2000 pour l’enregistrement des empreintes digitales des demandeurs d’asile, le système de surveillance radar Sive (Système intégré de vigilance externe) adopté en 2002 lors du sommet de Séville, la création de l’agence de surveillance Frontex en 2004 pour la coordination des opérations de contrôles sur la frontière extérieure des États membres, mais également l’implantation en 2015 des hotspots en Italie et en Grèce destinés à l’identification et au tri des demandeurs d’asile, suivie de l’accord UE-Turquie en 2016 marchandant au prix fort le retour des indésirables dans ce pays.
Ainsi, force est de constater que l’élaboration au niveau national et européen d’une menace migratoire, amplement légitimée par la théâtralisation de la frontière et par son traitement sécuritaire, a laissé la porte grande ouverte aux nationalismes identitaires. Il est pour autant souvent entendu que, afin de ne pas faire le jeu de l’extrême droite et de la laisser se hisser au pouvoir, les politiques dîtes modérées se voient contraintes de s’aligner sur un traitement plus strict en matière d’immigration. Ce discours réducteur et apologique a pour objectif principal de permettre d’occulter le questionnement même de la fonction des frontières, la politique restrictive et répressive menée depuis des années, et leurs fondements. L’importance ne semble donc pas être de distinguer lesquels des gouvernements libéraux ou nationalistes traiteront dans une logique politicienne le plus durement la question de l’immigration, mais plutôt de comprendre et d’analyser sur quels intérêts se basent cette surenchère sécuritaire. L’arrivée exceptionnelle en 2015 de réfugiés en Europe, si elle a remis au goût du jour la question des migrations, montre cependant aujourd’hui qu’elle n’était en rien une crise « migratoire », mais bien une crise politique, dont le « retour des frontières » est l’une de ses conséquences. La politique de fermeture et de consécration du tout sécuritaire ne doit pas non plus faire oublier que le problème réside bien dans le fonctionnement d’un système basé sur la ségrégation d’une majeure partie de la population, l’exploitation et l’accaparement des richesses. La montée des politiques réactionnaires et des nationalismes renaissant en Europe ne peut alors suffire à masquer la triste réalité d’un monde profondément inégalitaire. Ainsi, remettre en cause le bien fondé des frontières permet de questionner la fermeture face à l’ouverture, l’identité face à la mobilité, l’oppression face à la transgression. Peut être est-ce là le seul mérite qu’un monde borné et fermé sur lui même puisse apporter : une redéfinition en profondeur des limites et des séparations imposées par un système de frontières étouffant, et peut être bientôt fascisant.

Photos Stefania Mizara et Gabriel Tizón.